Thèse présenté à Faculté des Sciences de l'Université de Paris
pour obtenir le grade de Docteur es Sciences Physiques
par
Lucien Amy
Contribution à l'étude des propriétés et de la
structure des solutions et des gelées de gomme
soutenue le 13 juin 1934
devant la commission d'examen :
Auger, V., président
Mouton, H. et Darmois, E., examinateurs
INTRODUCTION
Les gommes hydrophiles
sont des produits d'excrétion d'origine végétale, amorphes,
incristallisables, neutres ou légèrement acides, donnant avec l'eau des
mucilages plus ou moins épais, soit qu'ils s'y dissolvent, soit qu'ils se
gonflent simplement au contact de ce solvant.
Un très grand nombre
d'espèces végétale sont susceptibles de produire des gommes hydrophiles. La
plupart d'entre elles appartiennent à la famille des légumineuses et à celle
des rosacées. A cette dernière se rattachent les arbres fruitiers de nos pays
produisant les gommes, dites indigènes, tandis que la première comprend
notamment les genres Acacia, et Astragalus qui fournissent les seules gommes
pratiquement utilisées (arabique et adragante). Rien. que pour le genre Acacia,
il existerait d'après M. le professeur Perrot, plus de 400 espèces
différentes.
Les gommes ont été
connues et utilisées à des fins thérapeutiques dès l'antiquité. Pline,
Dioscoride, Théophraste en font mention dans leurs écrits. A l'époque
moderne, les premiers mémoires traitant les gommes que nous avons retrouvés,
sont ceux de Prosper Albin et de
Jacob Dubois, mais il faut arriver à Vauquelin pour obtenir les premières
indications chimiques précises. Les auteurs qui ont étudié les gommes ont
cherché à élucider deux questions très différentes : origine et signification
physiologique d'une part, constitution chimique d'autre part. origine
anatomique est actuellement à peu près connue ; les gommes proviendraient
d'une modification des membranes cellulaires de l'assise génératrice (Lutz).
Cette transformation se propageant de proche en proche envahirait les
différents tissus, puis gagnerait les canaux, ce qui provoquerait
l'excrétion. La cause de cette altération est vraisemblablement très
variable. La gomme arabique se formerait à la suite de piqûres d'insectes
(Perrot), peut-être par contamination bactérienne, mais cette dernière
origine est encore discutée. On ignore en quoi consiste exactement la
transformation, car la composition des gommes n'est pas encore complètement
élucidée.
Les premiers auteurs qui
se sont occupés de rechercher les propriétés physiques et chimiques des
gommes paraissent s'être beaucoup préoccupés de les classer. Actuellement, on
se contente généralement de distinguer les gommes complètement solubles dans
l'eau, telles que la gomme arabique, les gommes demi-solubles (gomme de
cerisier) et les gammes insolubles (gomme Bassora). En fait, cette
distinction n'est qu'approximative. D'une part, il n'existe vraisemblablement
aucune gomme rigoureusement insoluble ou complètement soluble ; d'autre part,
il existe tous les intermédiaires entre ces deux catégories. Voici en effet
les valeurs de la proportion de la fraction insoluble d'un certain nombre de
gommes (Perrot, Lemeland, Gérard).
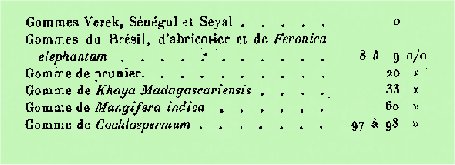
Ces valeurs ne sont
qu'approximatives, probablement parce qu'elles varient d'un échantillon à
l'autre. En effet, alors que Perrot indique que la gomme de Cochlospermum est
insoluble, Lemeland constate que 2,6 % sont solubles ; de même cet auteur
classe la gomme de Gezireh parmi les gommes entièrement solubles alors que
Vée l'indique comme presque entièrement soluble.
Les solutions de gommes
sont douées de pouvoir rotatoire (Biot). Cette grandeur est très variable
d'une espèce à l'autre et même pour une espèce donnée d'un échantillon à
l'autre. Voici en effet quelques-unes des valeurs obtenues par Vée, Lemeland
et Hamy :
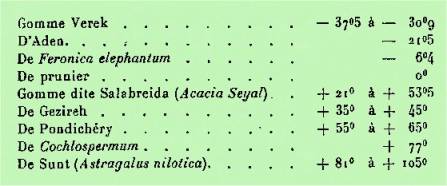
Ces valeurs montrent que
les substances renfermées dans les différentes espèces sont différentes les
unes des autres et sont vraisemblablement formées elles-mêmes de mélanges
dont les proportions varient avec les échantillons.
Toutes les gommes
renferment une certaine proportion d'eau généralement comprise entre 10 et 20
%. Par un chauffage prolongé à 100°, elles perdent cette eau sans que leurs
propriétés en soient modifiées.
Si l'on élève la
température jusqu'à 150°, les gommes solubles comme la gomme arabique se
transforment et deviennent insolubles (Frémy), sans que cette transformation
entraîne une nouvelle perte de poids (Gélis).
Une ébullition prolongée
dans l'eau ou l'action des alcalis à froid, produit la transformation inverse
et redissout la gomme Les gommes insolubles (gomme adragante) et la fraction
insoluble des gommes partiellement solubles (gommes de pays) se dissolvent de
la même manière (Frémy, Guérin). On pouvait donc penser que les différentes
gommes ne différaient entre elles que par une transformation de la fraction
soluble en insoluble (Frémy).
Une température
suffisamment élevée, transforme successivement les gommes en caramel, puis en
charbon, enfin, il reste toujours une petite quantité de cendres blanches.
Vauquelin effectuant
cette dernière opération simultanément avec du sucre de canne, du sucre de
lait, de la gomme arabique, de la gomme de pays et de la gomme Bassora, note
la similitude des résultats et en conclut que les gommes sont des sucres
imparfaits mélangés à une petite quantité de cendres.
La proportion de ces
cendres est assez variable. De même que le pouvoir rotatoire, mais dans des
limites beaucoup plus étroites, elle varie d'un échantillon à l'autre pour
des gommes de même espèce et surtout d'une espèce à l'autre. C'est ainsi que
Graeger a trouvé pour la gomme ara-bique, des nombres variant de 3 à 3,35 %
et que Lemeland a obtenu des nombres compris entre 2,3 % (gommes du Brésil
et de Kordofan) et 6 % (gomme de Cochlospermum).
Les cendres sont presque
exclusivement formées de chaux, magnésie et potasse. Les proportions de ces
éléments sont encore variables suivant les échantillons et les espèces.
Graeger par exemple a trouvé dans l'analyse des cendres de trois échantillons
de gomme arabique que la teneur en chauxvariait de 44 à 54 %, celle en
magnésie de 12 à 26 % et celle en potasse de 30 à 40 %.
En dehors des cendres,
les gommes ne renferment que du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et une
petite quantité d'azote inférieure à 1 p. 100, Cruickshands. Tous les auteurs
sont d'accord pour admettre que l'azote n'existe qu'à l'état d'impureté,
résidu probable du contenu cellulaire. Après élimination des cendres, les
gommes ne renferment que des substances ternaires.
Opérant sur des
échantillons purifiés (?) par récipitation au sous-acétate de plomb,
Berzélius a trouvé pour la partie
organique de la gomme arabique, une composition très voisine de celle du
saccharose C12H22O11.
Par oxydation de la gomme
arabique au moyen de l'acide azotique, Scheele avait obtenu un acide que
Laugier a identifié avec l'acide mucique obtenu dans les mêmes conditions à
partir du sucre de lait. D'autre part, le contact prolongé des gommes avec
les acides étendus les transforme et les décompose en produits plus simples :
les gommes insolubles se solubilisent dans l'eau, le pouvoir rotatoire des
gommes solubles se modifie (Béchamp); enfin, les Solutions normalement
inactives vis-à-vis de la liqueur cupropotassique deviennent fortement
réductrices. Dans le cas de la gomme arabique, la transformation est complète
après un traitement d'une heure environ à la température de 105-106° et en
présence d'acide sulfurique à 2 %. Le pouvoir rotatoire de la gomme passe
alors de — 30° à - 60° environ (Bourquelot). Dans la solution de gomme
arabique ainsi dégradée, Biot et Persoz, les premiers, ont entrevu
l'existence d'un sucre fermentescible. Les recherches de Scheibler et de
Kiliani ont permis d'isoler successivement deux sucres, l'arabinose et le
galactose. Pendant longtemps, les auteurs considérèrent les gommes comme
exclusivement formées de produits de condensation d'arabinose et de galactose
(mélanges d'arabanes et de alactanes) ; il aurait du reste été plus exact de
dire arabino-galactanes, puisque l'on n'avait pas isolé de produits
fournissant exclusivement de l'arabinose ou du galactose.
Lemeland par exemple
donne les nombres suivants obtenus en dosant les pentoses sous forme de
dérivés futurologiques .et le galactose à l'état d'acide mucique; pentoses
33,4 % (Cochlospermum) à 76,3 % (prunier) et galactose 13,4 % (prunier)
à 51,8 % (Feronica elephantum). La plupart des résultats de Lemeland sont
d'ailleurs fortement déficitaires en ce sens que la somme pentanes-galactanes
ne représente pas le poids total de l'échantillon analysé (elle n'atteint pas
70 % dans le cas de la gomme d'abricotier). Il était donc probable qu'il
restait d'autres éléments non dosés dans les produits d'hydrolyse. En effet,
dès 1910, Meininger établissait l'existence d'un méthylpentose dans les
produits d'hydrolyse de la gomme arabique, puis Schirmer obtenait également
un produit analogue à partir des gommes de Anegeissus latifolius et Odina
Wodier. Enfin, en 1929, Butler et Cretcher établissaient que le méthylpentose
de Meininger était du rhamnose et trouvaient en plus de l'arabinose et du
galactose l'acide d-glucuronique combiné molécule à molécule avec le
galactose à l'état d'acide aldobionique. La répartition des produits
d'hydrolyse de la gomme arabique étant finalement la suivante : acide
aldobionique 28,3 % ; rhamnose 14,2 % ; galactose 29,5 % et arabinose
34,4 %.
En résumé, la partie organique de la
gomme arabique (l'arabine) et vraisemblablement celles des autres gommes sont
des complexes ternaires formés par la condensation d'acides uroniques et de
sucres parmi lesquels on a déjà isolé le galactose, l'arabinose et le
rhamnose.
Quant au poids moléculaire de ce
complexe, le seul résultat certain dont on puisse tenir compte à ce sujet est
celui qu'aobtenu Graham a montré que
la gomme arabique ne traversait qu'avec une extrême lenteur lesmembranes de
parchemin, que c'était donc un colloïde dont le poids moléculaire était par
suite très élevé. L'étude de la dégradation de l'arabine avait conduit
O'Sullivan à proposer pour cette substance la formule C89H142O74, soit un
poids moléculaire de 2 394. Mais, d'après Scheibler les produits obtenus par
O'Sullivan seraient de simples mélanges de sucres.
Quelle relation
existe-t-il entre la partie minérale des gommes et la partie organique? Pour
Frémy, l'arabine serait un acide, l'acide gummique ou acide arabique, le
calcium, le magnésium et le potassium salifiant cet acide dans la gomme
naturelle. L'opinion de Frémy était encore très discutée au moment où nous
avons commencé notre travail et en 1920 M. le professeur Perrot pouvait
encore écrire que la question était entière.
Nous nous sommes proposé d'étudier la
nature de la combinaison entre la fraction minérale et la fraction organique
des gommes hydrophiles. Nous avons choisi parce que facile à se procurer la
gomme arabique comme gomme soluble et celle de cerisier comme gomme
insoluble.
Dès le début de nos
recherches, nous avons observé un certain nombre de faits nouveaux se
produisant au cours de la dissolution de la gomme arabique. Ces observations
nous ont conduit à séparer une fraction insoluble dans la gomme arabique
vraie. D'autre part, une étude critique des méthodes de préparation de
l'arabine nous a montré qu'il se produisait des modifications au cours de nos
opérations. Nous avons ainsi été amené à étudier une méthode de préparation
rationnelle de l'arabine et à étudier ses propriétés acides.
Après avoir établi d'une
manière certaine l'existence de - telles fonctions, nous avons étudié la
valeur de leur coefficient de dissociation par des mesures électrométriques,
puis nous avons cherché à contrôler les résultats par d'autres méthodes
physiques : le pouvoir rotatoire, la viscosité et la conductibilité. Nous
avons effectué un travail analogue pour la gelée de gomme de cerisier.
Au cours de ces différentes recherches,
nous avons constaté ; certains phénomènes particuliers se produisant pendant
la dissolution; pour approfondir ces phénomènes, nous avonsétudié la
diffusion des arabates.
Enfin, en discutant l'ensemble des
résultats, nous avons pu constater qu'aucune des théories sur la structure
des solutions colloïdales, exposées jusqu'ici, ne permettait de les
expliquer. Nous avons proposé une théorie nouvelle dans ce but.
Notre travail est divisé
de la manière suivante :
PREMIERE PARTIE. — Gomme
arabique.
1° Phénomènes se
produisant au cours de la dissolution : isolement d'une fraction insoluble ;
2° Préparation de l'arabine. Etude de
ses principales propriétés (acidité, pouvoir rotatoire, viscosité,
conductibilité diffusion, etc.) ;
3° Etude sommaire de la fraction
insoluble de la gomme arabique;
DEUXIEME PARTIE. — Gomme
de cerisier.
TROISIÈME PARTIE. —
Discussion des résultats.